samedi, 08 septembre 2018
Centenaire oblige...
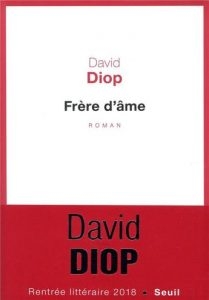
Il est difficile de retrouver parmi les livres de la rentrée dite littéraire, celui dont la lecture vous apparaîtra comme une urgence.
J’étais attentive cette année à ce qui pouvait paraître sur la Première Guerre Mondiale, commémoration du centenaire oblige. Et j'ai lu plusieurs livres de cette époque.
Mais la force de la littérature c’est son renouvellement perpétuel. Après les récits des témoins, comment un écrivain actuel peut-il, cent ans plus tard, se réapproprier une tragédie digne de l’Antiquité ?
C’est en cela que le regard nouveau de David Diop, dans son roman Frère d’âme paru récemment, est passionnant.
David Diop, né à Paris, a grandi au Sénégal. Avec ce roman, il introduit un personnage oublié de la guerre de 14/18: le tirailleur sénégalais. Frère d’âme est l’histoire de deux amis africains, Alfa Ndiaye et Mademba Diop, nés dans une colonie française qui s’appelait à l’époque Afrique Occidentale Française.
A l’âge de quinze ans, nous avons été circoncis le même jour. Nous avons été initiés aux secrets de l’âge adulte par le même ancien du village. Il nous a appris comment se conduire. Le plus grand secret qu’il nous a enseigné, est que ce n’est pas l’homme qui dirige les évènements, mais les évènements qui dirigent l’homme.
Si Alfa Ndiaye devient fou, c’est parce qu’il est resté aux côtés de son ami agonisant qui le suppliait de l’achever, et n’en a rien fait par respect des obligations morales et religieuses reçues du marabout.
Pour ne pas contrevenir aux lois humaines, aux lois de nos ancêtres, je n’ai pas été humain, et j’ai laissé mourir Mademba, mon plus que frère, mon ami d’enfance, mourir les yeux pleins de larmes, la main tremblante occupée à chercher dans la boue du champ de bataille ses entrailles pour les ramener à son ventre ouvert.
Alfa Ndiaye, en raison de comportements de plus en plus étranges, sera envoyé à l’arrière par son capitaine pour se faire soigner. Pour ses frères africains, il est devenu un « dëmm », un « dévoreur d’âmes », il fait peur à tous. Il est alors repris par son histoire africaine, à tel point qu’à la fin du roman les deux personnages, Alfa Ndiaye et Mademba Diop se confondent.
Le roman nous invite à une réflexion sur la sauvagerie de la guerre. Le narrateur africain dit ne pas comprendre pourquoi il faut se comporter en sauvage en sortant de la tranchée, pour redevenir « normal » au retour. Il montre également le choc culturel qu’a été cette guerre pour les tirailleurs sénégalais. Cela ne les a pas empêchés de devenir « frères d’armes » des Poilus français, comme le montre la belle histoire d’amitié du narrateur avec Jean-Baptiste, mais pas « frères d’âme » car leur âme était restée en Afrique.
12:06 Publié dans Au jour le jour, Coups de coeur, D'une génération à l'autre, Mon centenaire 1914/2014, Passages vers... | Lien permanent | Commentaires (6) | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer
Imprimer
jeudi, 08 mars 2018
Journée de la femme et printemps des poètes
Journée de la femme qui devient exclusivement journée de revendication de l'égalité entre homme et femme.
Il fut un temps très lointain où certes l'égalité n'existait pas mais où la femme était mise sur un piédestal.
Je parle de la Littérature courtoise du Moyen-âge.
Bien sûr je n'exprime aucune nostalgie et suis contente de vivre à mon époque.
Mais j'avoue que je préférerais qu'on m'écrive des poèmes plutôt que de diriger une entreprise du CAC 40.
Amours me fait desirer
Et amer
De cuer si folettement
Que je ne puis esperer
Ne penser
N'ymaginer nullement
Que le dous viaire gent
Qui m'esprent
Me doie joie donner,
S'amours ne fait proprement
Telement
Que je l'aie sans rouver.
S'ay si dur à endurer
Que durer
Ne puis mie longuement;
Car en mon cuer vueil celer
Et porter
Ceste amour couvertement,
Sans requerre aligement,
Qu'à tourment
Vueil miex ma vie finer.
Et si n'ay je pensement
Vraiement
Que je l'aie sans rouver.
Mais desirs fait embraser
Et doubler
Ceste amour si asprement
Que tout me fait oublier,
Ne penser
N'ay fors à li suelement;
Et pour ce amoureusement
Humblement
Langui sans joie gouster.
S'en morray, se temprement
Ne s'assent
Que je l'aie sans rouver.
Guillaume de Machaut

10:57 Publié dans Au jour le jour, D'une génération à l'autre, Passages vers... | Lien permanent | Commentaires (7) | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer
Imprimer
dimanche, 17 décembre 2017
Les gardiennes, le livre
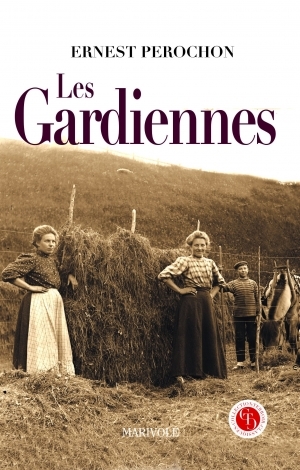
Le film de Xavier Beauvois "Les gardiennes" est absolument superbe et m'a donné envie de lire le roman qu'il a adapté, avec beaucoup de finesse et une grande humanité.

Je reconnais y retrouver mon ADN familial à plus d'un titre.
L'histoire est donc celle du film même si Xavier Beauvois a réduit le nombre des personnages se concentrant sur ceux qu'il a jugés les plus intéressants.
En 1915, début de l'histoire, ne famille de paysans nantis souffre comme les autres familles du départ des hommes pour maintenir le travail de la ferme.
Cette famille est dominée par une femme, déjà âgée surtout pour cette époque, Hortense Misanger, appelée la Misangère car à cette époque on féminise les noms de famille et surnommée la grande Hortense.
On peut dire que c'est la gardienne en chef pour les siens et pour tout le village.
Le roman débute par le poids de la responsabilité que les hommes partis se battre font peser sur leurs femmes.
"Il écrivait :
Vous devez travailler pour que les soladts ne manquent de rien ; vous devez travailler jusqu'à l'épuisement de vos forces, jusqu'à en mourir s'il le faut... La souffrance et la mort ne comptent pas plus pour vous que pour les combattants."
Contrairement à ce qui a pu être dit, pas plus le roman que le film ne suggère la moindre notion féministe. C'est l'exigence à l'état brut des hommes qui veulent retrouver en état leur bien.
La Misangère se soumet parfaitement à ces prescriptions qu'elle approuve complètement car elles correspondent à son caractère.
"D'abord, il lui semblait juste de durement peiner parce que les autres souffraient et que le travail est frère de la souffrance ; mais surtout les hommes s'acharnant aux oeuvres de destruction et de mort, la tâche première des femmes, qui est de conservation, lui apparaissait confusément avec son importance essentielle. Jeunes ou vieilles, les femmes étaient les gardiennes ; gardiennes du foyer, gardiennes des maisons, de la terre, des richesses, gardiennes de ce qui avait été amassé effort des âges pour faciliter la vie de la race, mais aussi gardiennes de ce qui pouvait sembler futile et superflu, de tout ce qui faisait l'air du pays léger à respirer, gardiennes de douceur et de fragile beauté."
C'est ainsi qu'Hortense Misandier mène son monde à la baguette, femmes et valets, sans aucune pitié pour la fragilité et la faiblesse. Même son mari plus vieux et impotent subit ses rudoiements. Ainsi a-t-elle le plus profond respect pour les femmes qui travaillent durement et un grand mépris de celles qui se relâchent.
C'est ainsi que la Misandière se trouve confrontée à des travailleurs défaillants : ses valets, des incapables, une fille qui pense davantage à faire la belle qu'à travailler au champ, une belle-fille courageuse mais souvent malade.
Son secours viendra de Francine Riant, une servante vaillante et dure à la tâche qui aurait tout pour lui plaire. Mais pour son entourage une fille de l'assistance est forcément une fille de rien. Francine est l'autre personnage fort de ce roman, une image lumineuse, même dans sa détresse quand les coups portés deviendront plus durs, et ils sont nombreux ces coups, tant la méchanceté et la jalousie vont l'accabler.
Comme dans le film, son amour naissant sera brutalement interrompu par une terrible injustice. Mais la résilience comme on dit aujourd'hui, sa force d'âme sont encore plus fortes que dans le film, Francine s'en sort, tournée vers l'avenir, transcendée par la vie qu'elle porte en elle.
Le roman se termine comme il a commencé, sur le personnage de la Misandière qui n'est plus la grande Hortense mais une vieille femme, détruite par les remords et abandonnée de tous.
Un très beau roman dont l'écriture savoureuse restitue la ruralité ancienne, celle de mes grands-parents. Ernest Pérochon est aussi à l'aise avec l'imparfait du subjonctif qu'avec le langage des paysans de ce temps :"cent soixante boisselées d'une terre sèche mais grenante", les emblavures ou emblaver, muser...
"Ce n'est pas un mince travail que de rentrer du foin au pays du Marais. Il faut le prendre sur le pré, le porter à la conche, dresser la batelée, conduire le chargement à la perche par les fossés étroits, parfois même le haler à bras."
En revanche si on a tendance à idéaliser cette société disparue comme un idéal d'humanité, on déchante. Si en effet, par nécessité, une grande solidarité se manifeste pour l'entraide dans les travaux des champs, jalousie et méchancetés dominent les relations au sein du village.
Pas de nostalgie donc pour une époque révolue.

21:42 Publié dans Ciné-club, D'une génération à l'autre, Passages vers... | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer
Imprimer
vendredi, 07 avril 2017
D'un Goncourt à l'autre
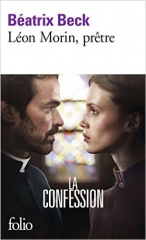 Il est de bon ton, et j'avoue l'avoir fait régulièrement, de critiquer les choix des jurés du prix Goncourt. Pourtant il en est d'excellents.
Il est de bon ton, et j'avoue l'avoir fait régulièrement, de critiquer les choix des jurés du prix Goncourt. Pourtant il en est d'excellents.
Le hasard a fait que j'ai lu très récemment et successivement, deux romans récompensés par ces jurés.
Le premier, "Léon Morin, prêtre", a été réédité récemment suite à la sortie du film "La Confession" de Nicolas Boukrief. Le second est le dernier Goncourt, "Chanson douce" de Leïla Slimani.
Un point commun entre ces deux romans : ils parlent de leur époque. Et de manière brillante et percutante.
"Léon Morin, prêtre" est le roman autobiographique de Béatrix Beck. Paru et couronné par le Goncourt en 1952, il raconte l'histoire d'une jeune veuve communiste, Barny qui, dans une petite ville de province, pendant l'occupation allemande. Elle rencontre un jeune prêtre pour le déstabiliser dans ses convictions. Il l'accueille avec intérêt, séduit par son intelligence et son esprit de répartie, et tous deux se prennent au jeu des échanges intellectuels.
Sauf que la jeune femme tombe amoureuse, le prêtre la repousse et c'est la rupture.
Très beau témoignage sur une époque avec deux personnages d'exception en des temps d'exception. Les épreuves révèlent. Barny jeune femme courageuse qui aide des juifs, soutient des collègues en difficulté, travaille et s'occupe de sa fille ne peut que susciter l'admiration. Quant à Léon Morin, personnage réel -Jules Albert Paillet 1914-1998- il nous épate par son positionnement avant-gardiste, sa proximité avec les gens, en particulier les plus modestes, et son rejet de la pratique religieuse ostentatoire des notables.
Les jeunes prêtres d'aujourd'hui pourraient s'en inspirer... La lecture de ce roman devrait être obligatoire au séminaire.
Deux scènes plus particulièrement montrent les difficultés que pouvaient rencontrer les prêtres de cette époque quand ils guidaient des fidèles.
Barny, récemment convertie, apprend qu'une jeune femme de sa connaissance, qui "fait la vie avec les Allemands" et leur fournit des renseignements, doit être exécutée par la Résistance. Elle expose au prêtre son cas de conscience car elle croise la jeune femme en question tous les jours... Après un dialogue remarquable au cours duquel Léon Morin amène Barny à réfléchir sur ses motivations, et sans doute également les siennes, il lui conseille de ne pas s'en mêler, de garder un secret que de toute façon elle n'aurait pas dû connaître. Condamnant ainsi une femme à la mort.
Quelques pages plus loin, c'est un jeune FFI membre d'un tribunal qui condamne des collaborateurs. Lui aussi vient confier au prêtre sa crainte d'être un assassin. Léon Morin lui répond :
"Si tu cales tu risques d'être remplacé par un autre moins consciencieux. Prends tes précautions, vérifie, fais ton devoir d'état. Il n'y a jamais de devoir au-dessus du devoir d'état.
Le bien commun passe avant ta petite sensibilité et avant ta coquetterie morale. Il y a des gens, la meilleure charité qu'on puisse leur faire, c'est de leur brûler la cervelle."

L'abbé Paillet, le véritable Léon Morin.
Ce roman n'a pas pris une ride : troublant, dérangeant. L'écriture est très contemporaine. Classique et fluide, alerte, s'appuyant essentiellement sur les dialogues. D'où la facilité de l'adapter au cinéma.
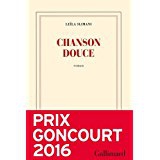 Tout aussi dérangeant mais passionnant m'a paru le roman de Leïla Slimani, "Chanson douce", dernier prix Goncourt. C'est un thriller qui commence avec l'assassinat, par leur nourrice, de deux enfants, une petite fille de quatre ans et un bébé.
Tout aussi dérangeant mais passionnant m'a paru le roman de Leïla Slimani, "Chanson douce", dernier prix Goncourt. C'est un thriller qui commence avec l'assassinat, par leur nourrice, de deux enfants, une petite fille de quatre ans et un bébé.
La famille a toujours été, depuis l'Antiquité, un lieu de tragédie. Caïn et Abel, Médée... Nous sommes donc dans une tragédie actuelle, de la société d'aujourd'hui. Dans nos esprits aseptisés par des images d'une famille harmonieuse, lieu de refuge, cocon protecteur, le réveil du tragique est insupportable. Pourtant sa forme change mais le mystère du tragique demeure. Pourquoi ?
L'auteure qui s'est inspirée d'un fait divers arrivé aux États-Unis, tente de répondre à cette question, nécessairement partiellement.
Un jeune couple de "cadres dynamiques" embauche une nourrice, la meilleure possible, pour s'occuper de leurs enfants. Une femme parfaite, propre, attentive à réaliser les désirs de chacun, non seulement ceux des enfants mais aussi ceux des parents trop occupés par leur profession et tellement fatigués. Et puis tout dérive progressivement... On se fait trop ami avec Louise, la nourrice, qu'on emmène en vacances. Trop de proximité alors qu'on n'est pas du même monde. Le monde de Louise c'est celui des nourrices qu'elle retrouve au square où elle est la seule blanche. Le monde de Louise c'est une vie d'échecs et de souffrances accumulées. Plus les parents "bobos" se rapprochent d'elle, plus ils accentuent la distance qui les sépare et plus cette distance devient insupportable. Jusqu'à la tragédie.
Ces deux beaux romans, à plus de cinquante ans d'intervalle, nous décrivent la société de leurs auteurs, car un bon écrivain n'est pas hors-sol, mais bien enraciné dans le contexte de son époque.
17:10 Publié dans Coups de coeur, Passages vers... | Lien permanent | Commentaires (9) | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer
Imprimer
lundi, 28 novembre 2016
Quelle terreur ?

Il y a quelques mois j'ai été très marquée par la lecture d'un petit livre de Frédéric Boyer qui s'appelle : "Quelle terreur en nous ne veut pas finir". C'est un écrivain dont j'ai déjà parlé, ce n'est pas un auteur facile mais percutant, dérangeant.
 Ce texte très court est à la fois un plaidoyer et un réquisitoire.
Ce texte très court est à la fois un plaidoyer et un réquisitoire.
Plaidoyer pour l'accueil des réfugiés, réquisitoire contre tout un discours lepenisé qui nous paralyse, s'insinue dans la société française comme un poison.
Frédéric Boyer démonte les mécanismes de nos peurs : peur d'être envahis, peur du déclassement, peur du remplacement. C'est un texte fort avec des accents prophétiques et poétiques. Des passages obscurs également.
Ce texte m'a donc remuée.
Je me suis rapprochée d'une association qui aide les demandeurs d'asile, Welcome, fondée par les Jésuites.
Welcome recherche des familles pour héberger un réfugié, entre deux et six semaines. Celui-ci est ensuite pris en charge par une autre famille.
J'en ai parlé à Roso qui n'était pas trop d'accord. Il est vrai que nous avons déjà un réfugié quasi permanent en la personne de notre fils aîné schizophrène. Welcome m'a alors proposé de devenir tutrice d'un demandeur d'asile, c'est à dire quelqu'un qui l'accompagne, fait le lien avec ses familles d'accueil. Pour cela j'ai suivi une formation assurée par le Secours Catholique.
C'est là que j'ai découvert l'incroyable complexité de la demande d'asile.
Je ne peux vous faire un résumé de cette formation c'est compliqué. Ce qu'il faut retenir c'est qu'il est extrêmement difficile d'obtenir le statut de demandeurs d'asile.
Il est dès le départ difficile d'en faire la demande.
 Si un réfugié est obligé de donner ses empreintes dans un pays européens dans lequel il arrive, il dépende de ce pays et ne peut aller ailleurs. S'il le quitte pour aller ailleurs il est réexpédié dans le pays dont il dépend.
Si un réfugié est obligé de donner ses empreintes dans un pays européens dans lequel il arrive, il dépende de ce pays et ne peut aller ailleurs. S'il le quitte pour aller ailleurs il est réexpédié dans le pays dont il dépend.
Évidemment que la France n'est souvent pas le premier pays dans lequel arrivent les migrants.
Voilà pourquoi les passeurs brûlent les bouts des doigts avec de l'acide et certains migrants le font eux-mêmes avec des barres de fer chauffées au feu.
Ensuite, quand le réfugié a obtenu le droit de déposer une demande, les démarches sont très longues et semées d'embûches.
Au bout du compte 31% des demandeurs d'asile ont, en 2015, obtenu leur statut en France. Soit 3000 personnes.
Je pense en reparler ici quand je serai opérationnelle !

15:13 Publié dans Au jour le jour, Coups de coeur, Passages vers... | Lien permanent | Commentaires (4) | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer
Imprimer
vendredi, 15 juillet 2016
Fatiguée
J'avais préparé pour ce week-end une note sur mes lectures d'été. Mais hier soir, au retour du feu d'artifice lyonnais, l'horreur m'a à nouveau assommée comme elle a bouleversé tous les Français.
Nous sommes sidérés, abasourdis, anesthésiés mais surtout fatigués par cette déferlante de haine.
Fatigués de pleurer, de nous émouvoir.
Fatigués de ces émotions inutiles en pensant et maintenant "à qui le tour, ça ne finira jamais."
Fatigués d'en parler, d'analyser, de chercher à comprendre.
Éprouvés et sans voix.
donc je n'ai plus la tête à mes lectures.
finalement je me suis réfugiée dans le dérisoire et j'ai fait de la confiture.

11:56 Publié dans Au jour le jour, Passages vers... | Lien permanent | Commentaires (7) | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer
Imprimer
jeudi, 14 janvier 2016
La mort de Victor Hugo

Continuons avec Victor Hugo.
Judith Perrignon, journaliste, a publié ce livre " Victor Hugo vient de mourir" qui relate l'événement phénoménal que fut la mort puis l'enterrement de Victor Hugo.
C'est un livre de journaliste, qui s'attache à rendre le caractère exceptionnel de l'événement plutôt qu'un roman, les personnages appartiennent à l'Histoire, et la fiction est quasiment absente sauf dans le ressenti des uns ou des autres.
L'événement a marqué cette fin du XIXÈME siècle, non seulement par l'immense notoriété du personnage mais aussi parce qu'il fut l'occasion d'un acte fondateur de la République à savoir la restitution de l'Eglise Sainte Geneviève à l'état qui en fit le Panthéon.
E n cette fin du mois de mai 1885, toute la famille est réunie autour du grand-homme qui est à l'agonie. Il a 83 ans. Impossible intimité, les bulletins de santé sont promulgués régulièrement à la foule massée devant sa porte. Victor Hugo n'appartient plus à sa famille, à ses petits-enfants qu'il adorait. On peut même se demander s'il n'est pas dépossédé de sa mort.
Victor Hugo appartient à la nation.
Quelle était la nation à cette époque ? C'est la troisième république, proclamée par Gambetta par Napoléon III qui avait exilé le poète. On est quelques années après la Commune, écrasée dans le sang. Victor Hugo n'a pas soutenu la Commune mais défendu l'amnistie pour les communards. C'est donc une république bourgeoise, qui a permis des avancées -liberté de la Presse, Lois Jules Ferry-et anticléricale.
Le lendemain de la mort de Victor Hogo se déroule au Pére Lachaise une manifestation de révolutionnaires qui rencontre une forte répression policière. On compte les morts.
Leur chef est un certain Maxime Lisbonne, qui avait été envoyé aux travaux forcés en Nouvelle Calédonie, a été gracié et se retrouve opposant au gouvernement.
Lisbonne et ses amis représentent le premier problème qui se pose au gouvernement chargé d'organiser le défilé des funérailles.
Autre composante à risques : les Anarchistes. Groupe politique très redouté à l'époque.
Tout ce beau monde veut défiler avec ses drapeaux, les rouges et les noirs. Interdiction formelle de la police.
Autre composante : les bourgeois. Eux n'appréciaient pas le poète jugé trop à gauche. Mais ils le revendiquent. On se met en quatre pour obtenir de la famille une lettre d'accréditation afin d'avoir une place en vue dans le défilé ou on loue à pris d'or un balcon sur le passage du convoi.
Ainsi est organisé ce défilé, chacun à sa place en fonction du groupe dont on se reconnaît.
Reste le peuple. Le peuple se retrouve lui, place de l'Etoile ou est exposé le gigantesque sarcophage. Et il rend hommage à sa manière, à travers une nuit de sombres bacchanales. Cela dure plusieurs jours...
Les funérailles de Victor Hugo, les plus imposantes jamais organisées à Paris, ont réuni deux millions de personnes.
17:57 Publié dans D'une génération à l'autre, Passages vers... | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |  Imprimer
Imprimer


